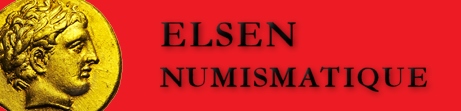Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1933. Il est chef de troupe des Ardents de Saint-Michel (avec le totem de « puce rieuse »). Docteur en droit de l’UCL, il participe à la campagne des dix-huit jours en mai 1940, lors de laquelle il est fait prisonnier. Après la guerre, il est avocat à la cour d’appel de Bruxelles (1940-1958), directeur politique de La Relève (1946-1958), chargé de cours à l’Institut Catholique des Hautes Études Commerciales (ICHEC) de Bruxelles (1959-1979). Il fait en parallèle une carrière politique : membre du PSC, conseiller au CPAS d’Etterbeek à partir de 1944, conseiller communal d’Etterbeek (1946-1958), puis d’Ixelles (1958-1964). Il sera aussi député de l’arrondissement de Bruxelles (1946-1968), secrétaire de l’Union parlementaire européenne (1947-1948), délégué belge au Conseil économique et social des Nations unies (1954) et à l’assemblée générale des Nations unies (1955). Il est ensuite président du Comité parlementaire militaire belge de l’OTAN à partir de 1956. Il est plusieurs fois ministre : de la Défense nationale dans le gouvernement Eyskens II (1958) et dans le gouvernement Eyskens III (1958-1961) où il aura à gérer la crise congolaise, de l’Intérieur et de la Fonction publique dans le gouvernement Lefèvre-Spaak (1961-1965). C’est à ce titre qu’il fera voter la fixation de la frontière linguistique. Il sera encore membre de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe (1954-1965) et de l’Assemblée consultative de l’Union de l’Europe occidentale (1954-1965).
Blog
Malengreau Roger
Il sort du Collège Saint-Michel (2e latine) en 1931, puis y revient pour suivre le CSS entre 1932 et 1934. Il entre ensuite à l’ERM. Il obtient son brevet militaire de pilote et est désigné pour le 2ème Régiment d’aéronautique. Le 15 mai 1940, il passe en France avec son unité. En juin 1940, il quitte la France via Port-Vendres et rejoint l’Angleterre à bord du S.S. Apata. Il rejoint les Forces belges on Grande-Bretagne à Tenby. Lorsque Göring déclenche la première phase de la Bataille d’Angleterre, il fait partie des 29 Belges intégrés dans le 87 Squadron du Fighter Command. Le 11 février 1941, un flight belge est créé au sein du Squadron 609 dont il fait partie. Le 6 juillet 1941, il est touché et doit se poser en planant dans un champ anglais. Il devient Flying Officer, puis est nommé Flight Lieutenant. En novembre 1942, il prend le commandement de la 349e escadrille basée à Ikeja au Nigeria. Sous ses ordres, cette escadrille effectue ses premières missions de surveillance des côtes occidentales africaines. En juin 1943, il rejoint le 272 Squadron, ensuite le N° 1 RAF Depot. De mai 1944 à janvier 1946, il occupe différentes fonctions à l’Inspectorat général de la RAF, à l’Inspectorat de la section belge de la RAF et au Ministère des Affaires étrangères (Belgian Liaison Mission à Berlin). Il entre dans la carrière diplomatique en 1945. Il est d’abord affecté à à Londres (1945-1948), puis en Chine (Nankin et Pékin), avant de devenir consul général à Lagos (1952-1957). Il est ensuite affecté en 1958 à notre Délégation à l’OTAN (à Paris). Il est nommé ambassadeur à Kuala Lumpur en 1960, puis au Chili (1964-1968). Il sera ensuite représentant de la Fédération des Industries belges au Congo/Zaïre.
Nothomb Patrick
Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1952. Il devint docteur en droit de l’UCL en 1957. Il embrassa la carrière diplomatique où il fut actif de 1960 à 2001. Consul général à Kisangani, il fut retenu en otage (4 août – 24 novembre 1964). Il fut très actif et créatif pour négocier avec le régime révolutionnaire de l’Armée Populaire de Libération (APL) du commandant en chef Olenga et du colonel Joseph Opepe la protection des membres de la communauté internationale, otages des révolutionnaires simbas. Lui et d’autres furent sauvés par les parachutistes belges lors de l’opération aéroportée Dragon Rouge du 24 novembre 1964, décidée quelques jours plus tôt par le premier ministre belge Paul-Henri Spaak. Il raconta cet épisode dans un livre Dans Stanleyville : journal d’une prise d’otage. Il fut ensuite successivement consul général à Osaka (1968-1972), chargé d’affaires à Pékin (1972-1974), devenant ainsi le premier diplomate belge en République populaire de Chine le 11 avril 1972, représentant permanent de la Belgique à l’ONU, New York (1974-1977), ambassadeur au Bangladesh et en Birmanie (1978-1980), directeur pour l’Asie au ministère des Affaires étrangères (1980-1985), ambassadeur en Thaïlande et au Laos (1985-1988). Son terme le plus long et le plus remarqué fut celui au Japon (1988-1997). Il fut encore ambassadeur en Italie, à Saint-Marin, à Malte et en Albanie (1998-2001). Après sa pension, il sera encore commissaire général d’Europalia-Italie (2002-2003) et conseiller du gouverneur de la province de Luxembourg. Père de l’écrivaine Amélie Nothomb, il était lui-même essayiste. La vie diplomatique de son père, et donc de sa propre enfance, sera un sujet d’inspiration pour l’écrivaine, notamment dans son roman Biographie de la faim. Il était également chanteur de nô, le théâtre japonais.
Olivier Louis
Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1940. Docteur en droit de l’université Catholique de Louvain (1946), ancien Bâtonnier du Barreau de Neufchâteau (1979-1980), il a mené une longue carrière politique dans les rangs libéraux. Conseiller provincial du Luxembourg (1954-1965), conseiller communal de Bastogne de 1959 à 1994, il devient bourgmestre en mai 1965 et le restera jusqu’en décembre 1976. Entré au parlement en mai 1965 comme député, il représentera l’arrondissement d’Arlon-Bastogne-Marche sous les couleurs du PRL jusqu’en 1992. Il sera ministre à plusieurs reprises chargé notamment du département des Classes moyennes (1973-1977) et de celui des Travaux publics (1981-1988) dont il fut le dernier titulaire au niveau fédéral. On se souviendra de ses réalisations importantes, lancées ou achevées sous lui : les autoroutes de l’Ardenne, E411 Namur-Neufchâteau et E25 Liège-Bastogne-Luxembourg, le terminal gazier du port de Zeebrugge, l’écluse de Berendrecht à Anvers, le remplacement du viaduc provisoire du Boulevard Léopold II à Bruxelles par un tunnel et la rénovation de nombreux bâtiments historiques comme le Théâtre Royal de la Monnaie. Avec le transfert des Travaux publics vers les régions décidé en 1988, il est le dernier titulaire de ce ministère au niveau fédéral. Fortement impliqué dans la vie locale, il était président honoraire du Conseil économique de la Province de Luxembourg, président fondateur du groupement des syndicats d’initiative du Cœur de l’Ardenne et Grand Maître de la Confrérie royale des Herdiers d’Ardenne. Pendant qu’il était ministre des Classes moyennes, il avait d’ailleurs obtenu la protection de l’appellation d’origine du Jambon d’Ardenne; vice-président de la fondation universitaire luxembourgeoise.Il était membre fondateur et past-président du Rotary Club de Bastogne, président d’honneur de la Fédération routière internationale et vice-président du Centre mondial de l’automobile Autoworld.
Pauwels René
Il sortit du Collège Saint-Michel (Ière moderne) en 1915. Il entra comme greffier à la Chambre des Représentants en 1920, nommé par le président socialiste Brunet. Comme chef de cabinet du Président – c’est une des fonctions du greffier – il travaillera pour Huysmans, Van Cauwelaert, Kronacker, Pierson et Van Acker. Peu après la guerre de 1914-1918, il sera associé au vote d’une loi assez curieuse. En 1921, les anciens combattant avaient envahi par centaines l’hémicycle pour protester contre la lenteur d’un projet de loi les concernant. La police ne pouvant entrer dans le Parlement, il avait été bien difficile de les en déloger. Il proposa alors à son président, puis au bureau de la Chambre, de faire voter une loi prévoyant de placer des grilles autour du Palais de la Nation et de délimiter un périmètre dans lequel aucun manifestant ne pourrait pénétrer qui devint la fameuse zone neutre.
Van Bunnen Gérard
Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1922 avec la médaille d’or. Docteur en droit et licencié en philosophie thomiste de l’UCL, devenu avocat, il remporta le Prix Le Jeune de plaidoirie en 1932. Il collabora à la Cité chrétienne. Il deviendra conseiller d'Etat et sera professeur de droit romain et de morale rationnelle à...
Van den Boeynants Paul
Il sortit du Collège Saint-Michel (4″ latine) en 1934, après y entré en 1926 en 10e primaire. Il poursuivit ensuite ses études comme apprenti boucher, d’abord chez son père, puis à Anvers. Il joua au football à la Royale Union Saint-Gilloise, mais à la suite d’une blessure au genou, il dut y renoncer. En 1940, il fut fait prisonnier, puis fut libéré en 1942. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il créa sa propre entreprise dans le secteur industriel de la viande avec laquelle il fit fortune. De 1949 à 1979, il fut député de Bruxelles du PSC-CVP. Il fut également échevin de Bruxelles. De 1961 à 1966, il fut président du PSC-CVP. Pendant cette période, il fut aussi à plusieurs reprises ministre des Classes moyennes. De 1966 à 1968, il fut premier ministre. Sur la scène internationale, son gouvernement s’impliqua dans l’OTAN (dont les sièges politiques et militaires s’installèrent en Belgique, à Mons pour le SHAPE et Bruxelles pour le siège) et la CEE. Il mit également au frigo le dossier linguistique, qui ressurgit toutefois en 1967, avec la crise de Louvain, qui provoqua la démission de son gouvernement en 1968. En 1969, il fut nommé ministre d’État. De 1972 à 1979, il fut ministre de la Défense nationale. D’octobre 1978 à avril 1979, il retrouva le poste de Premier ministre à la tête d’un gouvernement de transition. En 1979, il devint Vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale au sein du gouvernement de Wilfried Martens, mais démissionna bientôt. À partir du 8 octobre 1979 et jusqu’en 1981, il préside le PSC. Dans le but de rééquilibrer ce parti, trop lié aux syndicats chrétiens selon lui, il fonda le Centre des indépendants (CEPIC). En 1995, il se retira de la vie politique. Il fut encore pendant quelque temps le directeur de l’hebdomadaire satirique Pan. Il fut condamné à de la prison avec sursis pour fraude fiscale en 1986. Le 14 janvier 1989, il fut enlevé par la bande de Patrick Haemers. Séquestré environ un mois au Touquet, il fut libéré à Tournai le 12 février 1989, après le paiement d’une rançon de soixante-trois millions de francs belges. La conférence de presse qui suivit sa libération marqua les esprits.
Zimmer de Cunchy Alphonse
Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1928. Docteur en droit, il est membre de la rédaction de La Cité chrétienne, rédacteur de Jeune Europe et éditeur de L'Esprit nouveau. Il est en 1936 rédacteur en chef de l’éphémère L’Anti-Rex. Il coordonne Les jeunes et la transformation du régime (recueil des rapports présentés...
Moeremans d'Emaüs Roger
Il sortit du Collège Saint-Michel en 1908 après y avoir suivi le Cours scientifique supérieur, qu’il recommence l’année suivante. Il combattit en 1914-1918 comme aviateur-observateur. Cavalier, il décrocha la médaille de bronze avec son cheval Sweet Girl en concours complet par équipe aux Jeux olympiques d'Anvers en 1920. Lors des mêmes Jeux, il...
Delmer André
Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1934, avant de suivre le CSS dans le même collège. Devenu ingénieur civil des Mines UCL, après une incursion dans le secteur privé (charbonnage André-Dumont à Waterschei), il entre au corps des mines. Il est rattaché en 1945 au Service de Géologie de Belgique où il fera toute sa carrière jusqu’en 1981. Il en devient le directeur en 1966. Parallèlement, il enseigne à l’Université de Louvain et à l’Ecole industrielle supérieur Reine Astrid à Mons. Il mène des travaux scientifiques sur la géothermie en Hainaut, le stockage du gaz en Campine, la géologie des bassins houillers de Campine et de Hainaut et stimule la refonte de la Carte géologique de la Belgique. Il publie également des contributions à l’histoire de la géologie et rédige des dizaines de notices nécrologiques sur ses collègues. Il publie entre 1943 et 2013 des dizaines d’articles scientifiques. Secrétaire général de la Société de Géologie de Belgique de 1956 à 1969 et bibliothécaire, il en est le président de 1976-1977. Il devient membre de la Commission royale des monuments et sites (1983-1989) et membre correspondant (1983), puis membre (1992) et président de l’Académie royale de Belgique. Il y dirigera la Classe des Sciences. Il reçoit en 1978 le Prix Léopold von Buch de la Deutsche Geologische Gesellschaft, le ‘Nobel des géologues’. Il sera résistant pendant la guerre.
De Ruyt Franz
Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1925. Il écrit à cette époque dans l’hebdomadaire officieux du collège La Jeunesse poèmes et articles. Il fait une candidature en philologie et lettres à Saint-Louis. Devenu docteur en philologie classique de l’UCL, il devient étruscologue, archéologue et philologue. Il est professeur à l’UCL de 1943 à 1975, mais enseigne aussi dans plusieurs universités étrangères. Il est élu à la classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, correspondant en décembre 1970, membre titulaire en décembre 1979 et devient directeur de la Classe en 1986. Il sera membre de plusieurs sociétés savantes étrangères. Auteur de nombreux ouvrages, articles et recensions, mais aussi de chroniques radio-diffusées et de conférences. Il siège au comité de rédaction de nombreuses revues savantes. Il sera président de l’AESM de 1962-1966.
de Schoutheete de Tervarent Guy
Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1908. Il fait sa candidature en philosophie et lettres au Collège Notre-Dame de la Paix à Namur et obtient son doctorat en droit à l’Université catholique de Louvain où il accomplit, de plus, son service militaire à la Compagnie universitaire. Il s’engage comme volontaire dans le premier conflit mondial, ce qui lui vaut la croix de guerre et la médaille de l’Yser. Il sera diplomate dès 1915 et en poste à La Haye puis Tokyo et Pékin. Revenu en Europe, il est en poste à Berlin en 1933, en Hongrie en 1935, puis en Egypte de 1938 à 1946 et au Danemark de 1945 à 1952. Il terminera sa carrière comme envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire au Japon, entre 1954 et 1957. Il fut aussi un brillant historien de l’art et spécialiste de l’iconologie (décryptage approfondi du sens, parfois caché, des images du passé). Il publiera quelques ouvrages restés des références en la matière, tels La légende de sainte Ursule dans la littérature et l’art du Moyen Age (2 volumes publiés à Paris en 1931), Les énigmes de l’art (4 volumes publiés à Paris et Bruges entre 1938 et 1952) et Attributs et symboles dans l’art profane 1450-1600. Dictionnaire d’un langage perdu (3 volumes publiés à Genève entre 1958 et 1964). Elu correspondant à l’Académie royale de Belgique en 1956, il en devient titulaire en 1958 et est directeur de la classe des Beaux-Arts en 1964. Il y publie divers mémoires : De la méthode iconologique (1961), Présence de Virgile dans l’art (1967), Les animaux symboliques dans les bordures des tapisseries bruxelloises au XVIe siècle (1968). Par ailleurs, il est, dès 1934, membre de l’Académie royale d’archéologie de Belgique dont il sera président, de la Société pour le progrès des études philologiques et historiques et, dès 1958, de la commission de peinture ancienne des Musées royaux des beaux-arts.
Gochet Paul
Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1950. Il devient licencié en philologie romane de l’ULB, puis en philosophie à la même université. Il devient, dès 1961, l’assistant du meilleur connaisseur belge de la philosophie anglaise, Philippe Devaux, professeur à l’Université de Liège. C’est sous sa direction qu’il rédige une thèse de doctorat intitulée « Esquisse d’une théorie nominaliste de la proposition », soutenue en 1968. Après avoir été nommé 1er Assistant et Maître de conférences en 1969, il devient chargé de cours en 1972, puis professeur ordinaire. Il restera, jusqu’à l’éméritat en 1997, titulaire de la chaire de logique et d’épistémologie à l’Université de Liège. Il sera l’un des acteurs du rapprochement entre philosophes analytiques, logiciens, linguistes et philologues. Il participe aux travaux du Centre National de Recherches de Logique dont il sera le secrétaire de 1971 à 1988. Il est co-directeur à l’Institut des Hautes Études de Belgique, secrétaire et président de la Société Belge de Philosophie, vice-président de la Commission de philosophie du FNRS. Il participe aux réunions de l’Académie Internationale de Philosophie des Sciences ainsi qu’à celles de la Société belge de Logique et de Philosophie des Sciences. Il écrira cinq livres et plus de cent articles. Il est élu membre de la Classe des Lettres de l’Académie le 6 décembre 2004.
Grosjean Paul
Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1917. Il entra dans la compagnie de Jésus. Il étudiait les sciences humaines à Drongen lorsqu'il fut destiné (1919) par ses supérieurs à œuvrer chez les bollandistes. En 1921, Hippolyte Delehaye l'orienta vers l'hagiographie celtique et il se rendit à Oxford (Angleterre) pour commencer sa spécialisation...
Lemaître Georges
Il suit le CSS au Collège Saint-Michel en 1910-1911, après avoir fait ses humanités au collège jésuite du Sacré-Cœur à Charleroi. Il est ensuite admis à l’école des mines de l’Université catholique de Louvain en 1911. En 1914, il s’engage dans le 5e corps des volontaires et participe à la bataille de l’Yser. Après quatre ans de guerre, décoré de la croix de guerre, il quitte l’armée en tant qu’adjudant et reprend ses cours de mathématiques et de sciences physiques à l’Université catholique de Louvain en 1919. Cette même année, il obtient son baccalauréat en philosophie thomiste et entame son doctorat avec La Vallée Poussin. Afin d’obtenir une bourse de voyage, il rédige en 1922 un mémoire sur La Physique d’Einstein, lui permettant de remporter la distinction. Il écrit son premier article scientifique en août 1923. Il est admis cette même année à l’université de Cambridge comme étudiant-chercheur. Il passe l’année suivante au Harvard College Observatory de Cambridge (États-Unis), puis au Massachusetts Institute of Technology où il travaille sur plusieurs sujets : la relativité générale, l’étude des étoiles variables et une théorie d’Eddington tentant de relier l’électromagnétisme à la gravitation. En 1926, il soutient sa thèse sur le calcul du champ gravitationnel d’une sphère fluide de densité homogène. Il revient comme enseignant à la section francophone de UCL. Il fait ensuite de nombreux voyages aux États-Unis, rencontrant plusieurs fois Albert Einstein à Pasadena. Il est invité dans de nombreuses universités prestigieuses et gagne une réputation dans le grand public. En 1934, il reçoit la médaille Mendel de l’université Villanova, réservée aux scientifiques catholiques de haut niveau, et la même année, le prix Francqui. Sa « théorie de l’atome primitif », visant à expliquer l’origine de l’univers, constitue le fondement de sa théorie du Big Bang. Il la présentera dans une article de la Revue des Questions scientifiques. Parallèlement, il entre au séminaire (maison Saint-Rombaut de Malines) en 1920 pour être ordonné prêtre en 1923. Il entre dans la Fraternité sacerdotale des amis de Jésus à partir de 1922. Il réussira par la suite à concilier ses vocations scientifiques et religieuses, prônant, en particulier, une interprétation symbolique et non pas littérale de la Genèse. À partir de 1926, il est l’aumônier d’une maison d’étudiants chinois. Il est nommé chanoine honoraire en 1935. En 1960, il est nommé prélat domestique par Jean XXIII ainsi que président de l’Académie pontificale des sciences, dont il essaie de préserver la relative autonomie, au moins vis-à-vis de la Curie romaine.
Thibaut de Maisières Maurice (ou Maury)
Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1918. Bachelier en théologie du séminaire Léon XIII à Louvain, il étudia au collège pontifical belge de Rome en 1923-1925. Devenu ensuite docteur en philologie romane et licencié en archéologie et histoire de l’art de l’UCL, dès son entrée dans la vie professionnelle en 1927, il...
Coppens Paul
ll sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1910. Quand éclata la guerre, il était versé au bataillon universitaire où il suivait des études de droit à Saint-Louis, puis à l’UCL. Prisonnier à Paderborn, il fut relâché et s’engagea pour le théâtre d’opération africain où il séjourna jusqu’en 1919 et à propos duquel il...
Cornil André
Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1925. Prêtre du diocèse de Malines, il est vicaire de 1937 à 1944. Il est professeur de 1931 à 1939 au collège Saint-Pierre à Uccle et aumônier militaire. Il est aumônier des « Amis du septième art » à Tournai. Il part pour le Congo en 1949 et y reste jusqu’en 1960, séjour interrompu par deux retours en Belgique en 1953 et 1958. Il y tourne 77 films (dont 54 films éducatifs, 11 fictions et 12 reportages pour des sociétés comme l’OTRACO, l’Union minière et Symétain ou sur les villes de la colonie). Les films de fiction mettent en scène des acteurs congolais dans des films courts s’inspirant des contes naïfs et pittoresques congolais. A la tête de la production cinématographique coloniale officielle, il réalise aussi de nombreuses actualités sur des événements locaux. Ces réalisations marqueront le genre du film colonial. Il est ensuite le créateur de homes d’enfants ou pour handicapés, comme le Foyer Claire Fontaine à Lustin, dont il sera aumônier et directeur. Il devient aussi Monsieur Sport-Senior à l’Association du 3e Age.
Declève Henri
Il sort du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1941. Il suit une candidature en philosophie et Lettres à Saint-Louis, puis une licence pontificale en théologie à Innsbruck et une licence en philosophie et lettres au jury central. Il entre dans la Compagnie de Jésus qu’il quittera après quelques années. Il fait un doctorat en...
de le Court Robert
Il sortit du Collège Saint-Michel (rhétorique) en 1918. Il décrocha le diplôme de docteur en philosophie et lettres de l’Université catholique de Louvain (1935), de licencié en philosophie et en théologie, à Leuven et à Rome. Il se signala ensuite par ses qualités de pédagogue vivant et érudit auprès des élèves de 3e, de poésie et de rhétorique au collège jésuite Saint-Servais à Liège, pendant neuf ans (1927-1929, puis 1935-1942). Dès 1938, ses activités pédagogiques s’élargirent et se modifièrent (avec un intermède à Rome où il est appelé à Rome par le père Général dans un secrétariat pour la lutte contre le communisme). Il devint membre du nouveau Conseil des études de la province méridionale, avant de devenir le premier préfet des études en 1942 et le rester jusqu’en 1962, long temps où il prônera la nécessaire réforme des études dans les collèges jésuites et où il dut affronter les tempêtes de la guerre scolaire. Il était membre du bureau de la Fédération de l’enseignement catholique. On lui doit de très nombreux articles dans Famille et Collège, Humanités chrétiennes, et d’autres revues de pédagogie. Il rédigea aussi des livres d’histoire à l’intention des élèves Histoire contemporaine, à l’usage des collèges, athénées et pensionnats. et Histoire contemporaine, à l’usage de la seconde des humanités. Il fut encore recteur de l’Institut Gramme en 1965, archiviste et socius (secrétaire) du père provincial en 1971 et supérieur de la communauté d’Arlon en 1979. Il fut également vice-président de la commission belge de l’Unesco, de 1962 jusqu’à sa mort en 1986.