Samuel Beckett ou le salut par l’absurde
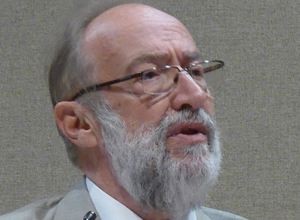
Horizons : C’est avec grand intérêt que nous publions ici un article de notre ami Jean van der Hoeden, diplômé de Philosophie de l’Université Saint-Louis et de UCL, professeur honoraire de littérature, consacré à son auteur favori Samuel Beckett. Jean est un habitué des conférences qu’il dispense avec érudition et brio à nos rhétoriciens. Qu’il soit remercié pour cette contribution au rayonnement de notre revue.
Samuel Beckett ou… le salut par l’absurde
En osant reprocher à Samuel Beckett de ne pas avoir été Français, Marcel Achard n’aurait-il pas mis en évidence, sans le vouloir, un des principaux avantages que Beckett aurait toujours eus par rapport au Français en question ? C’est qu’en effet, là où, dans une absence complète de gêne à vivre en bonne entente avec eux, Beckett a permis au hasard, à l’accidentel et à l’imprévu d’être, paradoxalement, les « fils conducteurs » de son œuvre, le Français, lui, avec l’horreur qu’il a par contre d’eux selon Bernanos, ne peut que se sentir très perdu lorsqu’il y est confronté. Pourtant, hasard, accidentel et imprévu sont des composantes si essentielles et incontournables de la réalité, qu’ils semblent, à certaines heures, en être l’unique visage ; Saint-John Perse aurait alors raison lorsqu’il écrit : « Il n’est rien de vivant qui de néant procède, ni de néant s’éprenne. Mais rien non plus ne garde forme ni mesure, sous l’incessant afflux de l’Être[1] ».
Quand Sam l’Irlandais débarque un jour à Paris avec ce qui restera jusqu’au bout son « humilité de catastrophe » – c’est celle qui ouvre au clown de Henri Michaux l’espace où « renaître à une nouvelle et incroyable rosée à force d’être nul et ras et risible[2] » –, c’est en réalité le Lucky d’En attendant Godot[3] qui, sans aucune intention méchante ni prétention déplacée, vient ici faire trembler ce qu’il y aura toujours d’artificiel dans le « cénacle » des Immortels. Pour Lucky comme pour Beckett, il ne peut être d’Académie digne de ce nom si elle n’est pas et ne reste pas d’abord l’« Acacacacadémie d’anthropopométrie[4] » où ne sont reconnus comme valables que « les labeurs de Fartov et Belcher inachevés on ne sait pourquoi de Testu et Conard[5] », ceux en fait où l’on ne s’offusque nullement de ne pas réussir à « déterminer la position de Neptune d’après l’observation des divagations d’Uranus[6] ».
L’immense modestie qui caractérise la personnalité de Beckett, metteur en scène de l’effacement, il la tient de l’Irlande dont il est resté un « originaire permanent », Irlande où la brume est d’abord le brouillard fécond du « peut-être », lequel interdit à la raison de cheminer autrement que par « oui » et par « non », exactement comme, sur la terre évoquée, on ne chemine que par monts et par vaux. Sur une terre comme celle-là, il n’y a rien d’étonnant à ce que les Vladimir et Estragon d’En attendant Godot ne puissent faire mieux que parler par « affirmations et négations infirmées au fur et à mesure[7] », manière de se retenir l’un l’autre de s’éloigner du vide que cultive l’œuvre de Beckett, celui qui est « au maximum lorsque presque[8] ». Que ces deux personnages aient une certaine prédilection pour le calembour, la chose doit tenir à ce que, pour celui qui les a créés, le calembour… « est au commencement[9] ».
Dans le paysage irlandais, la chouette chère à Beckett n’a bien sûr que faire du seul « Siècle des Lumières », elle qui, précisément, « proteste contre la lumière[10] », et cela parce qu’elle a besoin d’ombre pour voir clair – comment ne craindrait-elle pas le pire lorsque « le vieux cochon de soleil rapplique, ponctuel comme un bourreau[11] » ? Et comme, dans ce même paysage, « Errare humanum est » signifie en premier lieu : « Marcher, c’est cela qui fait l’homme », rien, mais alors vraiment rien ne sert de « s’en prendre à sa chaussure alors que c’est le pied le coupable[12] ». Lucky, dont la lourde valise ne contient d’ailleurs que du sable, est là pour le rappeler : la condition humaine est, par essence, « itinérante », et cela avec tout ce qu’il y avait d’emblée d’Atlantide dans la Terre-Neuve et tout ce qui restera de Terre-Neuve dans l’Atlantide ; Lucky aurait-il eu une montre, elle n’aurait jamais indiqué d’autre heure que « l’heure qu’il a toujours été et sera toujours, celle qui unit aux beautés du trop tard les charmes du prématuré (…)[13] ».
Assurément, avec ses histoires qui se terminent d’autant moins bien ou mal qu’elles n’ont déjà pas de début et que, dès lors, on ne peut y « regarder » que « à perte de passé et d’avenir[14] », Beckett n’a rien d’un marchand de « sens à tout prix », un de ces marchands qui tentent donc de persuader leurs clients que « remède » et « solution » sont la même chose, même quand il s’agit de venir en aide à l’homme aux heures où il se sent plus particulièrement pris dans la parfois très pénible « difficulté d’être ». Parmi ces marchands, on trouve en bonne place les différents « humanismes », tous finalement ces « systèmes à penser ou à croire » dont se méfie d’autant plus le personnage de Watt[15] que, s’il « pose » et « se pose » sans doute un certain nombre de questions, c’est sur l’arrière-fond de celle, éternellement sans réponse, qu’il « est » d’abord lui-même.
« Il restera toujours plus facile d’élever un temple que d’y faire descendre l’objet du culte[16] », écrit Beckett ; et c’est de tout type de construction intellectuelle qu’il est aussi question ici, qu’elle soit philosophique ou théologique par exemple, comme les « systèmes à penser ou à croire » évoqués ci-dessus et où le seul espoir laissé à celui qui spécule est de finir par tomber, sans qu’elle soit pourtant autre chose qu’une spéculation supplémentaire, sur… « la spéculation qui est la bonne[17] ». Qu’au moins alors, indique Beckett, les idées « claires et distinctes » dont Descartes a tant fait l’éloge acceptent de s’ouvrir plus généreusement à l’épreuve de l’obscurcissement et du doute ; qu’au moins alors, indique-t-il également, les mots eux-mêmes – et ils se résument très souvent à être un rempart contre le vide[18] – acceptent de subir l’épreuve de l’immersion dans les profondeurs du silence, immersion tant redoutée par le Monsieur Spiro que rencontre Watt ; si ce grand bavard, surtout à propos de Dieu, s’accroche et même se cramponne au mensuel catholique qu’il édite, c’est en effet d’abord pour « maintenir la tonsure hors de l’eau[19] ».
L’absurde chez Beckett n’a jamais rien eu à voir, ni de près ni de loin, avec celui d’un Sartre par exemple, chez qui, parce que justement « système », l’absurde est très rassurant : il garde une dimension d’« assurance-vie quand même » ; la Rive gauche est toujours une Rive, alors que chez Beckett, on ne cesse d’être dans la « dé-Rive ». L’absurde chez Sam l’Irlandais, c’est en effet ce qui est « en dehors de tout ordre », y compris donc celui que ne peut s’empêcher d’être et d’ériger une « philosophie » de l’absurde ; il est là où se contentent d’être, au cœur de ce qui les unit, sans que rien n’y soit déjà rapport théorique à quelque idée et parmi d’autres choses qui « ne consentent à être nommées qu’à leur corps défendant[20] », l’eau, l’air, la terre et le feu dont la terre d’Irlande est la synthèse toujours en mouvement, et où hauts et bas se rappellent sans cesse que, « paysagement parlant », ils sont seulement des moments différents du moral ou de l’humeur de l’Être. Tant que la Terre-Neuve et l’Atlantide n’oublieront pas qu’elles sont chacune plus que la moitié de l’autre, les clochards, épaves et ratés de toutes sortes qui peuplent l’univers de Beckett trouveront toujours, pour s’en réjouir infiniment, que « être l’ami du soleil venté, du vent ensoleillé, en plein vent, en plein soleil[21] », c’est déjà un immense cadeau pour un « escaladeur de l’extrêmement bas ».
Tout faire passer par la « catastrophe », même prise au sens premier du mot – c’est alors simplement celle qui reconduit à l’absurde tel qu’il nourrit la pensée et l’écriture de Beckett –, beaucoup se gardent bien d’y consentir, persuadés qu’ils sont, malgré tout, que, en fossoyeur délibéré de l’humanité, Sam l’Irlandais n’a jamais poursuivi d’autre but que de ne rien laisser debout ni de l’homme ni de ce qu’il croit. Pourtant, la « catastrophe » au sens où Beckett l’entend est d’une incroyable richesse : elle seule semble permettre de retrouver l’« oiseau-oiseau[22] » – celui qui n’a pas encore été réduit à n’être plus que « oiseau « de proie » » ou « oiseau « de compagnie » » –, le vrai « Petit Beurre » – celui qui n’est encore « ni Lu ni Connu[23] » –, et peut-être même, hypothèse qu’on peut avancer chez Beckett[24], le « vrai » Dieu – celui qui ne se laisse ramener ni au Dieu que les écoles « avec Dieu[25] » disent avoir dans leur camp, ni à celui dont les écoles « sans Dieu[26] » se vantent d’avoir pu faire l’économie, tous deux, en réalité, « des » dieux. Ces retrouvailles, c’est l’absurde tel que Beckett le ressuscite, qui les rend possibles ; quant à pouvoir jouir un peu d’elles, cela suppose d’abord que l’on ose faire comme Beckett ce que, avec le courage du Clown cher à Michaux et à qui il importe, « pour arracher l’ancre qui tient son navire loin des mers, de lâcher ce qui paraissait lui être indissolublement proche[27] », il faisait, à l’occasion d’un de ses jeux préférés, lorsqu’il était enfant, et que, finalement, il a toujours continué à faire, même si autrement :
« L’un des jeux favoris de Sam consistait à grimper au sommet de l’un des pins qui dominaient la maison ; il se lançait dans le vide, bras et jambes écartés dans son désir de voler jusqu’à l’extrême fin de sa chute libre où il souhaitait de tout son cœur qu’une des larges branches du bas l’arrêtât avant qu’il ne s’abattît au sol[28] ».
[1] SAINT-JOHN PERSE, « Poésie », allocution prononcée à Stockholm le 11 décembre 1960 à la cérémonie de remise du prix Nobel de littérature.
[2] Henri MICHAUX, « Clown », extrait de L’espace du dedans, Paris, Gallimard, Pages choisies/Poésie, 1966, p. 249.
[3] Samuel BECKETT, Paris, Minuit, 1952.
[4] En attendant Godot, p. 59.
[5] Ibidem, p. 60
[6] Samuel BECKETT, Bande et Sarabande, Paris, Minuit, 1994, p. 109.
[7] Samuel BECKETT, L’Innommable, Paris, Minuit, 1953, p. 7.
[8] Samuel BECKETT, Cap au pire, Paris, Minuit, 1991, p. 56.
[9] Samuel BECKETT, Murphy, Paris, Minuit, 1965, p. 52.
[10] In L’amitié de Beckett, André BERNOLD, Paris, Herman-Éditeurs des sciences et des arts, 1992, p. 18.
[11] Samuel BECKETT, Mercier et Camier, Paris, Minuit, 1970, p. 184.
[12] En attendant Godot, p. 12.
[13] Mercier et Camier, p. 129.
[14] Ibidem, p. 38.
[15] Samuel BECKETT, Watt, Paris, Minuit, 1968.
[16] Samuel Beckett, L’Innommable, Paris, Minuit, 1953, p. 95.
[17] Ibidem, p. 49.
[18] C’est ce qui ressort nettement de « Oh ! les beaux jours », Samuel BECKETT, Paris, Minuit, 1963.
[19] Watt, p. 29.
[20] Ibidem, p. 81.
[21] Watt, p. 169.
[22] Mercier et Camier, p. 167.
[23] Murphy, p. 73.
[24] Voir ici par exemple Samuel Beckett et la question de Dieu, Jean van der HOEDEN, Paris, Cerf, 1997.
[25] En attendant Godot, p.16.
[26] Ibidem.
[27] Henri MICHAUX, « Clown ».
[28] Deidre BAIR, Samuel Beckett, Paris, Fayard, 1979, p. 25.
